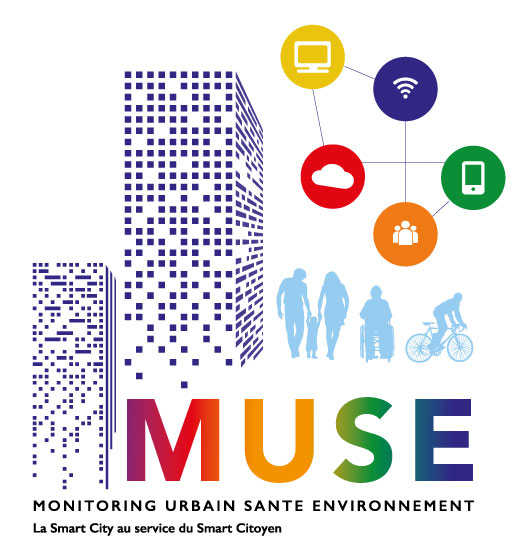La pollution de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), c’est le principal risque environnemental pour la santé à l’origine chaque année, de 6,5 millions de décès prématurés (dont 3 millions liés à la seule pollution de l’air extérieur). En France, Santé Publique France estime que la pollution par les particules fines émises par les activités humaines est globalement à l’origine d’au moins 48 000 décès prématurés par an. Le risque principal est lié à l’exposition chronique, et non aux pics de pollution. Il est nécessaire d’avoir les informations sur la qualité de l’air afin d’adapter au mieux ses activités. Ceci est particulièrement important pour les personnes vulnérables (enfants, femmes enceintes, personnes âgées, patients avec une pathologie cardiaque ou respiratoire) mais aussi pour la population générale notamment pour les activités physiques. C’est l’objectif du projet MUSE.




Le Laboratoire de soins pharmaceutiques et de santé publique (L2SP) travaille dans le domaine de la qualité de l’air extérieur depuis 2010 au travers de projets européens, nationaux et régionaux. Dans le cadre du projet MUSE, les actions sur la qualité de l’air extérieur sont menées en étroite collaboration avec l’APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) de PACA et nationale, présidée par le Pr Denis CHARPIN. L’APPA est un des partenaires du projet MUSE.