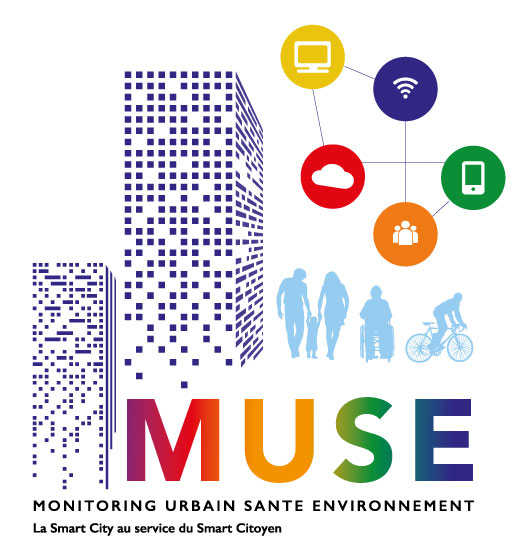La détermination des risques pour la santé nécessite de connaître cinq composants fondamentaux : la source de pollution, la nature et l’évolution des polluants, l’exposition, la dose et l’effet.
Seule la multidisciplinarité regroupant métrologistes, médecins, épidémiologistes, ingénieurs, biologistes, toxicologues, hygiénistes etc. permet d’appréhender au mieux l’impact sur la santé de l’homme des facteurs d’environnement.
De plus en plus d’études montrent un impact croissant de la dégradation de notre environnement sur le développement des maladies chroniques (cancer, diabète, troubles de la reproduction, obésité, troubles du développement cérébral…).
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), jusqu’à 20% des cancers sont d’origine environnementale.
L’exposition chronique à la pollution de l’air est à l’origine d’environ 48 000 décès prématurés par an en France. Le coût annuel sanitaire de cette pollution est estimé entre 68 et 97 milliards d’euros. Le coût annuel des perturbateurs endocriniens est évalué à plus de 150 milliards d’euros en Europe en termes de santé publique. Le bruit seul des transports représente en France un coût sanitaire de plus de 11 milliards d’euros. Les nouvelles technologies (nanomatetriaux, biotechnologies, objets connectés) présentent des risques émergents sur lesquels les incertitudes scientifiques restent très importantes.