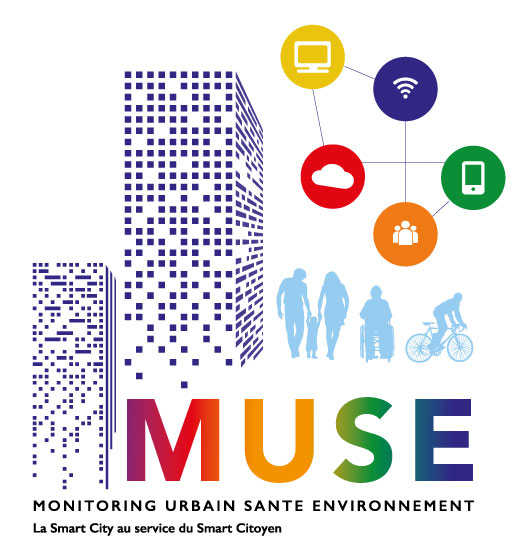Lorsqu’on parle de qualité de l’air, on pense spontanément à la pollution atmosphérique ou qualité de l’air extérieur.
Or, l’air intérieur constitue un axe fort de progrès en santé environnement. C’est désormais une des priorités des différents plans santé environnement au niveau national et régional. En effet, la présence dans les environnements intérieurs de nombreuses substances et agents (chimiques, biologiques et physiques (géno)toxiques, infectants ou allergisants à effets pathogènes) ainsi que le temps passé dans des espaces clos (en moyenne 70 à 90 %) en font une préoccupation légitime de santé publique.
D’après différentes enquêtes « logement », on estime environ 40 % des habitations présentant au moins un problème de qualité (le défaut le plus fréquent étant l’humidité).
Le Laboratoire de soins pharmaceutiques et de santé publique travaille dans ce domaine depuis 2010. Depuis 2016, les actions sur la qualité de l’air intérieur sont menées en étroite collaboration avec l’APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) de PACA et nationale, présidée par le Pr Denis CHARPIN. L’APPA est un des partenaires du projet MUSE.
La qualité de l’air intérieur est importante pour la santé car nous passons entre 70 et 90% de notre temps dans des espaces clos. Ceux çi vont présenter des polluants spécifiques, aggravés par une partie des polluants provenant de l’air extérieur. Des mesures simples se révèlent efficaces afin de préserver une qualité de l’air intérieur satisfaisante, comme notamment des aérations régulières. Pour les personnes présentant des pathologies pour lesquelles l’environnement intérieur peut être particulièrement néfaste pour la santé, des visites à domicile peuvent être réalisées sur prescription médicale par des conseillers habitat santé (CHS) afin de réaliser un diagnostic précis de la qualité de l’air.